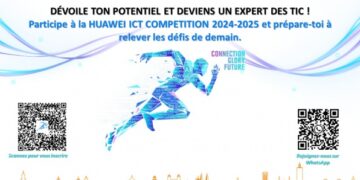Le groupe Meta va supprimer son programme de fact-checking aux États-Unis. Mark Zuckerberg s’est notamment exprimé sur les enjeux politiques de cette décision à quelques jours de l’investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Le groupe Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) a annoncé le 7 janvier 2025 sa décision de mettre fin à son programme de fact-checking aux États-Unis. C’est dans un message sur les réseaux sociaux que le patron et fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que le groupe souhaitait se « débarrasser des fact-checkers, (chargés d’écarter les fake news des réseaux sociaux) pour les remplacer par des notes de la communauté, similaires à X (anciennement Twitter), en commençant par les États-Unis ».
D’après Zuckerberg, « les fact-checkers ont été trop orientés politiquement et ont plus participé à réduire la confiance qu’ils ne l’ont amélioré, en particulier aux États-Unis ». À cette annonce, Meta a ajouté un communiqué officiel précisant qu’une fois le nouveau synthème opérationnel, ce seront des utilisateurs qui attribueront des notes communautaires aux contenus publiés sur les différentes plateformes du groupe.
Cette initiative devrait être introduite dans les prochains mois aux États-Unis. Il est dorénavant possible pour les utilisateurs américains de Facebook, Instagram et Threads de s’inscrire pour éventuellement faire partie de ce programme. Celui-ci se place directement dans une démarche en lien avec la politique actuelle clairement annoncé par le patron de Meta.
Dans une vidéo publiée le jour de l’annonce sur le site officiel de Meta, Mark Zuckerberg clarifie face caméra les positions du groupe. « Nous avons essayé en toute bonne foi d’adresser ces problèmes sans devenir les arbitres de la vérité, mais les fact-checkers ont été trop orientés politiquement et ont plus participé à réduire la confiance qu’ils ne l’ont améliorée, en particulier aux États-Unis » Sur cette lancée, le groupe devrait revoir et « simplifier » ses règles concernant les contenus sur l’ensemble de ses plateformes et « mettre fin à un certain nombre de limites concernant des sujets, tels que l’immigration et le genre, qui ne sont plus dans les discours dominants » selon Zuckerberg.
Cette annonce prend place à quelques jours de l’investiture de Donald Trump. Le futur président avait par le passé accusé Meta de soutenir des discours progressistes et favorables aux idées de gauche.
Un changement de direction vis à vis de Donald Trump
La décision de mettre fin au fact-checking chez Meta est assimilée à une volonté de favoriser la liberté d’expression. Ce postulat est le même mis en avant par le propriétaire du réseau conçurent X (anciennement Twitter), Elon Musk, fervent allié de Donald Trump.
À l’image de celui-ci, Mark Zuckerberg semble s’inscrire dans une volonté d’entretenir les meilleures relations avec le futur président. D’autres initiatives en faveur du leadeur des républicains ont déjà été prises, comme la désignation de fidèles de Trump dans des postes d’importance, comme le lobbyiste Joe Kaplan, à la tête des affaires publiques de Meta. Sur cette même volée, Meta devrait déplacer ses équipes « confiance et sécurité » de l’État de la Californie, généralement plus démocrate, à celui du Texas plus républicain.
La France voit une volonté « d’instrumentaliser la liberté d’expression”
De son côté, la France ne manque pas d’exprimer son scepticisme devant l’initiative de Meta. Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, partage d’ailleurs son opinion dans une interview publiée dans Le Monde le 9 janvier 2025. Elle dénonce le choix de Meta d’adopter “une fonctionnalité de modération utilisée aujourd’hui par d’autres plateformes, dont X, et qui fait l’objet d’une enquête de la Commission européenne”.
Selon la membre du gouvernement, “Il faut arrêter d’instrumentaliser la liberté d’expression”. Les États-Unis et Meta n’ont, d’après la ministre, “pas à nous demander de repenser la manière dont nous garantissons la liberté d’expression en Europe et en France depuis deux siècles dans la Déclaration des droits de l’homme”.